- Accueil
- > Numéros parus
- > 2023-7
- > Dossier
- > Retours d’expériences. Quand les réserves s’ouvrent au numérique : le cas de la collection d’éventails du musée Sainte-Croix de Poitiers
Retours d’expériences. Quand les réserves s’ouvrent au numérique : le cas de la collection d’éventails du musée Sainte-Croix de Poitiers
Par Inès Ferron et Mathieu Fonroques
Publication en ligne le 18 mars 2024
Résumé
Cet article se veut relater l’histoire d’une exposition, Du bucolique à l’allégorique : un demi-siècle d’éventail. La collection du musée Sainte-Croix dévoilée, portée par Madame Aude Nicolas et cinq de ses étudiants en Master Histoire de l’art, patrimoine et musées à l’Université de Poitiers, mais surtout l’expérience du numérique vécue par ce groupe d’étudiants. Ils ont été confrontés aux difficultés que pose le numérique mais ont aussi constaté tous les bénéfices qu’il a apporté à cette exposition, qui fut à la fois virtuelle et matérielle. Ce retour d’expérience a pour objectif de montrer les atouts du numérique dans le monde culturel moderne.
Mots-Clés
Article au format PDF
Retours d’expériences. Quand les réserves s’ouvrent au numérique : le cas de la collection d’éventails du musée Sainte-Croix de Poitiers (version PDF) (application/pdf – 3,3M)
Texte intégral
Introduction
1Humanités numériques, cette expression, cette idée, qui peut nous interroger, nous étudiants et futurs professionnels du patrimoine, est aujourd’hui une expression essentielle dans le monde culturel. Pourtant, d’un premier abord, le musée est un espace physique de conservation et de valorisation des collections. Avant ce projet, notre vision du numérique le délimitait au rôle de support, d’outil parmi tant d’autres, utile à la communication, la médiation et la régie. Ce projet tuteuré proposé par Aude Nicolas, traitant du numérique et ayant pour finalité une exposition virtuelle, nous a paru une belle opportunité d’aborder de manière concrète l’utilisation des humanités numériques.
Histoire de l’exposition
2Cette exposition en partenariat avec le musée Sainte-Croix devait mettre en lumière leur collection, jamais exposée, d’éventails du XVIIIe siècle. L’exposition qui en résulte, Du bucolique à l’allégorique : un demi-siècle d’éventails. La collection du musée Sainte-Croix dévoilée, a été présentée au musée Sainte-Croix entre mars et octobre 2022, et prolongée dans sa version numérique sur le site internet du réseau Aliénor1.
3Cette exposition ne devait se tenir que de façon virtuelle. Ce choix était lié aux multiples contraintes du musée. Celui-ci ayant déjà sa propre programmation d’expositions, il était compliqué d’y insérer une nouvelle présentation, et ce d’autant plus en ces temps de pandémie. Il aurait également fallu prendre en compte l’espace nécessaire à une telle réalisation. Le choix d’une exposition numérique répondait aussi aux contraintes de conservation, la fragilité des éventails, constitués de tissus, papier, nacre, marqueterie, os ou ivoire, nécessitant un nombre de lux limité, une manipulation très délicate et une hygrométrie contrôlée. La photographie permettait justement de limiter ces risques de dégradation par la lumière ou par la manipulation.
4Pour jouer le rôle de commissaire d’exposition, nous avons dû à la fois nous renseigner sur les éventails et sur les différents types d’expositions numériques. Comme pour tous projets d’expositions, il a fallu faire des choix, et dans un premier temps, sélectionner les éventails. L’ensemble de la collection ne pouvait pas être présenté, car certains étaient trop dégradés. Nous avons donc choisi de présenter des éventails représentatifs des différentes modes du XVIIIe siècle, leurs décors peints comme leurs montures témoignant d’un savoir-faire d’excellence. Le choix s’est toutefois révélé difficile, tous ayant une particularité digne d’être présentée. Pour justifier ce tri, nous nous sommes interrogés sur l’histoire de ce colifichet et sur sa fabrication au XVIIIe siècle. Nous avons également tenté de proposer des éventails composés de matériaux différents pour être les plus exhaustifs possible. Ce choix a dû être étayé par nos recherches sur le sujet. Après cette première sélection, nous avons entrepris de plus vastes investigations sur le sujet et sur nos éventails. Les notices ont été rédigées, puis nous avons affiné cette première sélection.
5Une fois le fond maîtrisé, nous avons dû nous intéresser à la forme. Comment mettre en valeur des éventails sur un écran, sans pour autant faire une galerie de photographies ? Comment équilibrer le contenu scientifique et l’image ? Comment la rendre attractive, en d’autres termes comment avoir le « clic » ? Nous avons étudié les exemples existants en réfléchissant à ce qu’il ne fallait pas faire, aux erreurs et aux atouts de chacune des expositions numériques consultées. Le choix du titre a également été sujet à de nombreuses discussions, comme pour la couleur du fond. Ces décisions sont complexes et pourtant essentielles. Le titre doit être compréhensible, percutant et susciter l’intérêt. Quant à la couleur, elle doit créer un contraste avec les éventails tout en permettant une lecture confortable du texte, sans agresser ni fatiguer le regard.
6Pour concevoir notre exposition, nous nous sommes inspirés de ce qui existait ailleurs. Nous avons donc scindé les expositions virtuelles en deux groupes, celles qui avaient eu lieu en musée et avaient ensuite été transformées en expositions numériques, et celles conçues uniquement et directement pour les supports multimédias. Les expositions virtuelles où l’internaute se promène sur l’écran comme dans la salle n’ont pas retenu notre attention. Le regard ne pouvant pas toujours se focaliser sur un tableau, le fait qu’il n’est pas forcément possible de cliquer dessus pour avoir plus d’information, ou encore l’impossibilité de déplacer une œuvre pour la comparer à une autre, ont participé à ce refus. De plus, il n’a pas forcément été possible de lire les cartels, ni les titres des œuvres. Si le choix d’écrire en blanc sur gris se justifie pour une exposition physique, celui-ci perd de sa lisibilité sur les écrans. En outre, en l’absence de zoom, les panneaux de salle ne sont pas tous lisibles : souvent, seule une poignée de tableaux bénéficie de cartels accessibles depuis nos écrans. Pour les expositions numériques pensées comme telles dès l’origine, nous avons regretté le manque de simplicité, les œuvres et le contenu scientifiques n’étant pas toujours en relation, ou l’interface pas assez intuitive.
7Le choix de la qualité des images à proposer s’est révélé également très important. Le musée Sainte-Croix nous a donc fourni des photographies en haute définition. Cette qualité d’image permet aux visiteurs de s’approprier l’éventail et de l’observer à sa guise.
8Au sujet de la question du montage informatique et de la mise en ligne, le choix fait d’emblée par notre directrice de projet, en concertation avec le musée Sainte-Croix, a été de de recourir aux services numériques du réseau Aliénor, dont le musée est membre. Ce réseau des musées de Nouvelle-Aquitaine permet de mutualiser les compétences, qu’elles soient professionnelles ou scientifiques, mais aussi les supports informatiques, les applications et les techniciens. Ainsi, un musée de modeste taille peut bénéficier des applications réalisées par et pour un musée de plus grande envergure, et les modifier pour adhérer à son projet, sans avoir à débourser autant que s’il avait acheté seul un produit à une entreprise spécialisée. Les outils élaborés par le réseau Aliénor profitent à tous les musées adhérents, et sont créés en commun, ce qui permet aussi bien de performer dans la gestion et la régie des œuvres, que dans la mise en valeur des collections. Pour notre exposition, nous avons donc communiqué nos souhaits de présentation à l’informaticien du réseau, habitué à monter des expositions virtuelles (fig. 1).
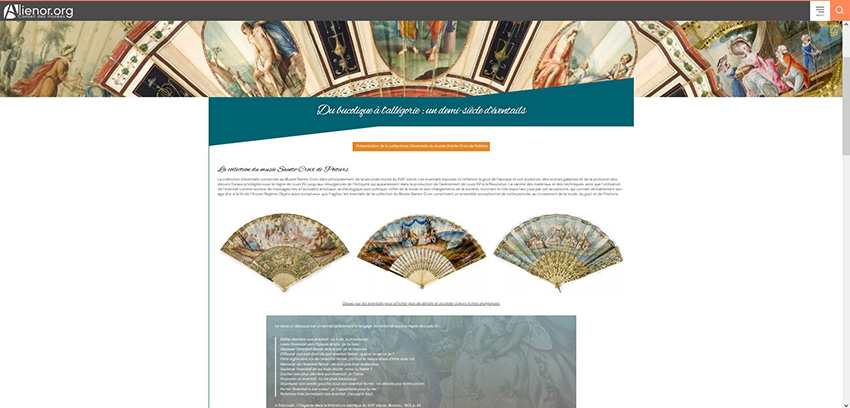
Fig. 1. Capture d’écran de la page d’accueil de l’exposition virtuelle Du bucolique à l’allégorique : un demi-siècle d’éventails
Voir l’image au format original
Alienor.org, Conseil des musées.
9Alors que notre travail touchait à sa fin, une bonne nouvelle nous est parvenue. Le musée souhaitait matérialiser l’exposition durant l’année 2022. Toutefois, de nombreuses contraintes et questions sont survenues. Comment transformer une exposition virtuelle, très riche en contenu, en exposition physique ? Comment l’intégrer dans le parcours du musée ? Nous avons dû réduire drastiquement nos textes et nous adapter à la charte graphique du musée. La fragilité des éventails et la muséographie nécessaire à leur présentation au public ont amené le musée à nous proposer de diviser l’exposition en deux temps. Une première exposition sur les mois d’avril à juin et la seconde de juillet à septembre, en faisant tourner les collections. La difficulté consistait aussi à savoir comment scinder l’exposition en deux. Après concertation, notre choix s’est porté sur une séparation chronologique, afin d’assurer une cohérence stylistique entre les éventails proposés, et d’inviter le visiteur à revenir pour voir la seconde partie (fig. 2).

Fig. 2. Vitrine de l’exposition physique au musée Sainte-Croix (septembre 2022)
Voir l’image au format original
Photographie : Inès Ferron et Mathieu Fonroques, 2022.
10À cette occasion, le musée nous a également permis de produire un petit livret explicatif papier mis à la disposition des visiteurs (fig. 3) et invités à mettre ces éventails en rapport avec leur collection d’arts graphiques. Pour ce faire, nous avons suivi le conseil de Raphaële Martin-Pigalle, conservatrice au musée Sainte-Croix, et fait le choix de lier notre propos à quatre portraits d’hommes et de femmes exécutés par Jean Valade (1710-1787), exposés par couple. Ces pastels du XVIIIe siècle représentent des aristocrates, et les femmes que nous avons choisies sont portraiturées tenant entre leurs mains des éventails, en écho à ceux présentés dans les vitrines (fig. 4).

Fig. 3. Couverture et page de crédits du livret mis à la disposition du public dans le cadre de l’exposition physique au musée Sainte-Croix (mars-octobre 2022)
Voir l’image au format original
Ville de Poitiers.

Fig. 4. Mise en rapport des pastels de Jean Valade et des éventails
Voir l’image au format original
Photographie : Inès Ferron et Mathieu Fonroques, 2022.
Exposition numérique et apport
11Le fait de réaliser une double exposition, à la fois virtuelle et physique, nous a offert un « terrain de jeux » bien plus grand que si nous n’avions réalisé qu’une exposition physique. Inévitablement, ce projet nous a amenés à confronter les deux modes d’exposition, complémentaires mais néanmoins différents. L’exposition physique nous prépare de façon pratique aux fonctions muséales, avec son lot de contraintes et de normes. Ce fut notamment le cas des cartels astreints à un nombre de caractères limités, ce qui nous a contraints à synthétiser voire à abréger leurs contenus. Cependant, l’exposition virtuelle nous a autorisés à aller plus loin dans notre liberté de conception, tant sur le fond que sur la forme. Par conséquent, le numérique est devenu un véritable apport atout dans le cadre de cette exposition. Ces apports peuvent être résumés en deux points essentiels :
12- Apport scientifique : nos textes et nos cartels sont accessibles en intégralité via le lien de l’exposition virtuelle. Ils contiennent de nombreux détails, des informations concernant l’analyse stylistique, les interprétations des décors. De plus, il nous a été possible de justifier le choix des éventails exposés. Aussi, que le public ait vu ou non l’exposition au musée Sainte-Croix, l’exposition virtuelle contient l’intégralité des contenus scientifiques.
13- Apport aux différents publics : il est incontestable que l’exposition virtuelle ait un apport considérable pour les différents types de publics, et cela pour plusieurs raisons. Notre exposition se déroulant en deux temps (le premier au printemps et le second sur la période estivale), il aurait pu s’avérer compliqué pour les visiteurs de venir par deux fois au musée, aussi l’exposition virtuelle remédie à cela en complétant la visite. En outre, le site internet du réseau Aliénor propose une multitude d’expositions et de contenus scientifiques. Enfin, le numérique offre à la fois une esthétique plus dynamique et se révèle être un support très accessible, gratuit et disponible aussi bien sur tablette que sur smartphone. Cet atout ouvre l’accès à un public plus large. Et cela d’autant plus en raison de la pandémie à cause de laquelle les institutions culturelles se sont ouvertes et fermées aux gré des vagues de COVID. Ajoutons que, grâce au numérique, les expositions sont disponibles pour une durée beaucoup plus longue, bien supérieure aux deux fois trois mois de l’exposition traditionnelle, cette limite étant établie par la fragilité des objets exposés.
14Tous les apports que nous venons de lister nous ont permis d’observer l’importance des humanités numériques pour les expositions ainsi que pour leur mise en valeur. L’expérience nous a également fait prendre conscience de notre peu de maîtrise des humanités numériques face à l’ensemble et à la diversité des outils. La crise du COVID a, pour tous, mis en évidence l’importance du développement des nouvelles technologies et d’Internet dans tous les domaines. La culture n’a évidemment pas fait exception à cette nouvelle règle. En tant qu’étudiants confrontés à ces changements, la création de cette exposition nous a fait comprendre l’intérêt majeur que représentait ce champ d’activité. Grace aux compétences de chacun, au partenariat avec le musée et à l’informaticien du réseau Aliénor, nous avons pu réaliser l’exposition virtuelle, en connaître les tenants et les aboutissants, acquérir une méthode et mettre en pratique nos années d’études. À ce jour, connaître et maîtriser les humanités numériques de manière approfondie, avant d’entrer dans le milieu professionnel, nous semble indispensable.
15Tous ces apports offerts par l’exposition virtuelle nous ont amenés à changer notre façon de percevoir les humanités numériques. L’outil informatique devient, grâce à elles, une véritable extension du musée. L’accessoire numérique se transforme en un support aux multiples possibilités, permettant d’allonger les expositions, d’en créer d’autres et de valoriser des collections inaccessibles. C’est également un moyen de toucher un public plus large, plus éloigné du monde muséal ou d’un musée. À l’aide du support web, n’importe quel internaute, où qu’il se trouve dans le monde, peut visiter notre exposition. La mise en place de réseaux de musées et la mutualisation des savoir-faire en matière de nouvelles technologies ne peuvent qu’enrichir cette force de frappe.
Documents annexes
- Capture d’écran de la page d’accueil de l’exposition virtuelle
- Vitrine de l’exposition physique au musée Sainte-Croix (septembre 2022)
- Couverture et page de crédits du livret mis à la disposition du public dans le cadre de l’exposition physique au musée Sainte-Croix (mars-octobre 2022)
- Mise en rapport des pastels de Jean Valade et des éventails
Notes
1 Exposition Du bucolique à l’allégorie : un demi-siècle d’éventails (URL : https://www.alienor.org/publications/2298-du-bucolique-a-l-allegorie-un-demi-siecle-d-eventails)
Pour citer ce document
Quelques mots à propos de : Inès Ferron
Quelques mots à propos de : Mathieu Fonroques
Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)