- Accueil
- > Numéros parus
- > 2018-3
- > Dossier
- > #Operaplot
#Operaplot
(ou la twitterisation de l’opéra)
Par David Christoffel
Publication en ligne le 02 mars 2020
Table des matières
Texte intégral
1De 2009 à 2012, chaque mois d’avril, des internautes mélomanes se retrouvaient sur Twitter pour jouer au concours #Operaplot. Pour stimuler leur participation, le Metropolitan Opera et le Los Angeles Opera mettaient en jeu des places de spectacle pour les gagnants et faisaient participer des chanteurs de renom au concours. Le jeu consistait à résumer un opéra en un tweet. En 2011, une internaute avait par exemple résumé Carmen en « Feuilleton espagnol en français finissant par la mort de la mezzo à une corrida. ». Cette même internaute (Katherine B. Dalin) avait ramené l’intrigue de Cosi fan tutte à deux phrases : « Des femmes dupent mystérieusement leurs petits amis avec de fausses moustaches. Ce qui prouve que les femmes sont inconstantes et les hommes faciles à duper. » Le caractère cocasse de ce type de pitch semble tenir d’un glissement de valeur de l’objet opératique et confirmer le slogan de la chaîne YouTube L’opéra et ses zouz : « Un opéra, quand tu le résumes, c’est comme les feux de l’amour. » On relève alors que l’opération de traduction ludique ne revendique pas forcément une fonction de vulgarisation (si cela devient du soap opera, on a conscience de ne plus réellement parler du genre opéra), mais revendique un nouvel ordre de jouissance du canon lyrique : la compression de pitch.
Un palmarès catégorique
2En explicitant les procédés stylistiques mis en œuvre et en analysant le jeu relationnel organisé sur le réseau social, nous pouvons vérifier qu’au lieu d’un renouvellement du public, #Operaplot active un espace de célébration malicieuse du grand répertoire. À partir du corpus fourni par la « Provisional Master Operaplot List1 », en plus des procédés de style, nous pouvons observer les actions génériques opérées par les participants du concours sur le résumé d’opéra. Le palmarès du concours offre lui-même quelques catégories :
31. La meilleure référence à la Pop Culture, dans un tweet de @EvieBelievie qui plote Carmen : « Don José, juste avant de me tuer, je pense que je devrais faire comprendre que nous étions sur une pause ! ».
42. Le meilleur #Operaplot moderne, de @Djliss, en référence à Freitag aus Licht de Stockhausen : « Kickin’ avec Caino, Sittin’ avec Adam, Kickin’ avec Caino, Sittin’ avec Adam, c’est vendredi, Friday#operaplot ».
53. Une mention spéciale pour la meilleure parodie de chanson : de @SamNeuman pour Das Rheingold : « Je vois que vous baignez dans le Rhin avec l’or, que je t’aime, et va te faire foutre et baiser Flosshilde. »
6Même si les catégories peuvent être formées au fil de la production du corpus, dans ces trois cas comme typiques, c’est la capacité de consacrer un sous-genre au moment même de l’inventer qui est remarquable. Le titre des mentions spéciales est révélateur, puisqu’il s’agit chaque fois d’insister sur la capacité à passer la frontière entre la culture populaire et la culture savante en maintenant l’une et l’autre en deux champs de référence encore assez distincts pour polariser le jeu. Le fait de faire un « Friday#operaplot » vaut à la fois comme hommage à la formidable appropriabilité du dispositif #operaplot et à l’œuvre de Stockhausen qui, dès lors, deviennent compatibles grâce à un nouveau domaine, de l’ordre d’une tiers-culture.
7Si le concours a tellement adapté ses catégories aux productions candidates, c’est en effet que le jeu insistait sur les capacités de Twitter à intégrer des conversations ludiques sur l’opéra, un peu plus que sur la force de l’opéra à s’intégrer dans Twitter. Et pour conforter l’idée que le jeu #Operaplot célébrait davantage la complicité web entre connectés que l’opéra : le quatrième prix spécial récompense le Meilleur Fan Art #Operaplot pour une aquarelle Madame Butterfly réalisée par @Frindley.
Le Fan Art pour revendication
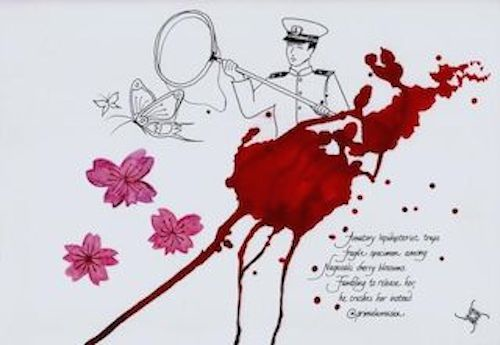
8Avant de consacrer le palmarès, The Omniscient Mussel avait publié une « Fan Art Gallery ». Avec quelques œuvres très schématiques.
Le strip Dr Who et Dr Faust
« The first LOL Catz Operaplot »
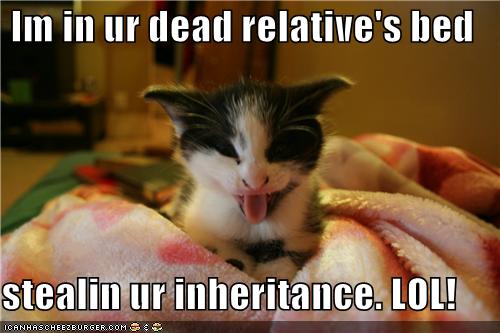
9Le lolcat est le genre le plus courant du « mème », défini comme : « une image combinant une photographie, généralement un chat, avec une légende humoristique et idiosyncrasique dans un anglais écorché »3. Le mot « mème » apparaît d’abord dans Le Gène égoïste de Richard Dawskins qui le définit, en 1976, comme une « unité d’information contenue dans un cerveau, échangeable au sein d’une société4. » Vincent Glad explique que « Les “mèmes”, c’est précisément cette époque où les ruses, les braconnages, le murmure inlassable de la consommation culturelle active devient visible grâce au web5. » Il s’agit donc de catégoriser l’#Operaplot à travers un jeu de projection dans un espace d’échanges de contenus. En convertissant l’intrigue d’opéra en support de concours de tweet, #Operaplot fait du résumé d’opéra un objet de consommation, avec tous les détournements que ce statut permet. Michel de Certeau observait dans L’invention du quotidien, que l’objet de consommation a justement la caractéristique de construire son histoire avec « ses ruses, son effritement au gré des occasions, ses braconnages, sa clandestinité, son murmure inlassable. » De sorte que le croisement entre culture savante et culture populaire n’a pas plus de valeur propre, dans l’économie du trafic d’informations, que le croisement entre un fragment de culture savante et un autre fragment. @EvieBelievie gagne le prix de la meilleure référence Pop Culture (pour l’operaplot de Carmen), en donnant « The first LOL Catz Operaplot » avec un montage texte-photo en cross-over.
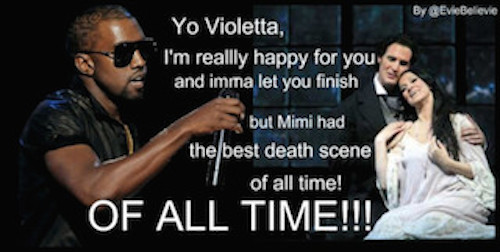
10#Operaplot place donc au même niveau le jeu de réflexivité d’un cross-over entre deux opéras. Ainsi, le croisement La Bohème et La Traviata permet à @SamuelSakker de « Faire d'une pierre deux coups : Dieu que je regrette que nous n’ayons inventé la pénicilline à ce jour. » Dans un humour digne du hashtag historique #TraduisonsLes, les internautes activent leur complicité autour des personnages d’opéra en cherchant un plaisir de partage au regard duquel les tweets #Operaplot sont comparables aux pratiques fictionnelles développées par d’autres communautés de fans sur Internet.
11Après des travaux fondateurs dans le champ des fanstudies, Henry Jenkins (de l’Université de Californie du Sud) s’intéresse aux pratiques transmedia et souligne comme le goût des internautes à transformer les informations qu’ils manipulent, jusqu’au patrimoine culturel, va jusqu’à inquiéter les médias industriels qui le perçoivent comme une perte de contrôle sur la circulation de l’information et, potentiellement plus graves pour eux, un détachement progressif des flux de capitaux indexés à leurs contenus6. Le fait est que les médias traditionnels sont mis en ballottage par ces pratiques. En termes d’économie de l’attention, il est évident que le temps investi par les internautes à jouer avec les résumés d’opéras, est autant de temps qu’ils ne passent pas à lire Diapason ou consulter le site de France Musique. C’est pourquoi, dans l’analyse des procédés stylistiques employés par les internautes, nous pourrions nous demander en quoi la narration d’origine est déterminante.
12Pour répondre à un premier niveau, relevons quelques quantités sur le choix des ouvrages « operaplotés ». Sur quelques 1200 plots : Aïda : 56 plots (4,67 %) ; Carmen : 35 plots (2,92 %) ; Don Giovanni : 35 plots (2,92 %) ; La Bohème : 35 plots (2,92 %) ; Rigoletto : 27 plots (2,25 %) ; Turandot : 26 plots (2,17 %) ; Peter Grimes : 25 plots (2,08 %) ; Cosi fan tutte : 24 plots (2 %)7. On peut être étonné que Peter Grimes enregistre un meilleur score que La Flûte enchantée (qui est l’objet de moins de 2% des plots) ou que Norma est deux fois moins cité qu’Albert Herring et trois fois moins que Gianni Schicchi. Même si les valeurs absolues en jeu ne sont pas assez robustes sur le plan statistique pour en tirer des conclusions de tendance, elles sont tout de même révélatrices du fait que le jeu suppose un corpus d’opéras canoniques, sans toutefois le respecter.
13Le fait qu’Aïda l’emporte aussi massivement est amplifié par la sur-participation de certains internautes. Deux ou trois internautes font 5 ou 6 tweets différents pour Aïda. Le record étant John Shaw qui consacre 19 tweets à l’ouvrage. John Shaw a contribué au concours à hauteur de 45 tweets, mais Aïda est le seul ouvrage qu’il investit plusieurs fois, qu’il « multiplote ». Il offre différentes manières de « ploter ». Cela peut prendre la forme d’une moralité synthétique : « L'homme est forcé de se débarrasser de la femme, doit faire semblant de vouloir épouser sa fille, mais après tout ça, ils réussissent le test, heureux dénouement. », ou encore : « Ne pas tuer votre femme enceinte, sinon vous deviendrez un idiot. » Il peut aussi être une description avec plaisir de démystification dans la fausse innocence : « International Tournoi Medieval et Concours de beauté suivie par des accusations de sorcellerie révélées fausses par mort subite. » ou : « Obsession sur un objet que l'on ne peut pas obtenir, où tout le monde meurt à sa poursuite, la plupart avec des noms bibliques. »
14Les compositeurs les plus représentés sont, dans l’ordre décroissant : Puccini (10,01 %8), Verdi (9,5 %9), Mozart (8,92 %10), Wagner (6,78 %11), Britten (3,92 %12), Bizet (2,92 %). Au-delà du fait que deux italiens arrivent en tête, il est notable que Britten apparaisse dans le Top 5. Le succès des opéras de Britten (Peter Grimes, Albert Herring et La Tour d’Ecrou) semble confirmer l’hypothèse de Jenkins : le jeu 2.0 s’affranchit des valeurs des opérateurs de prescription traditionnelle, c’est-à-dire les médias verticaux comme Diapason et France Musique que nous prenions en exemple. #Operaplot aime à varier les modes d’encapsulage de l’intrigue. En effet, les onze tweets produits sur Le Tour d’Ecrou, déclinent un panel de traits stylistiques : le résumé sous forme de petite annonce : « Recherche : Nounou. Doit aimer les fantômes pédophiles, les enfants effrayants. Contactez-nous pour plus de détails, puis plus jamais13. » ; le cross-over par comparaison : « C’est un peu comme La Mélodie du Bonheur, mais avec des fantômes et des angoisses freudiennes au lieu de la mièvrerie & des nazis14. » ; le double cross-over de décryptage : « Mélangez une partie de Mary Poppins et une partie du 6e Sens. Tournez jusqu'à ce soit vissé15. » ou le décryptage par requalification générique : « Fantôme homme et fantôme femme rencontrent un garçon et une fille. Entourloupes surnaturelles finissant en snuff movie16. Le garçon survit ; des années de thérapie probables17. »
15Nous pourrions reconduire le même type de remarques au sujet des deux ouvrages emblématiques du minimalisme à l’opéra : Einstein on the beach et Nixon in China. L’un des Runners Up18 fait un « Nixon va en Chine. » et souligne le fait qu’il s’agit bien d’un #Operaplot minimaliste de l’opéra minimaliste en complétant avec un hashtag « # Minimaliste operaplot ». L’enjeu de minimisation de l’intrigue devient alors le ressort principal au nom du fait que l’on entend jouer avec l’esthétique minimaliste. Twitter est ainsi investi pour ses possibilités narratives d’autant plus inépuisables que la brièveté relance les manières de consumer du minimum.
« Plotage » et minimalisme
16Les tweets #operaplot en référence à Einstein on the Beach font directement référence au livret et à l’emploi de l’arithmétique comme texture narrative anti-dramatique : « Einstein on the Beach : 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 819 ». Le jeu de sous-dramatisation des enjeux opératiques est comme annulé par le fait que l’opéra de Philip Glass se place justement en-deçà de l’enflure dramatique suffisante pour que son dégonflement puisse être amusant. Au point que les tweets #operaplot en référence à Einstein on the Beach tournent facilement au commentaire du caractère sous-dramatique du texte : « Einstein on the Beach : Plus de nombres que votre manuel d’algèbre20. » Ou bien, il s’agit de jouer le jeu de faire semblant de prendre la narration minimale pour une vraie narration, pour minimiser encore autrement : « Divers comptage et solfège, un type joue du violon et M. Bojangles21.» Ainsi, la liaison entre l’indigence diégétique et la situation opératique construite, en une seule phrase : « Tout le monde rencontre Einstein et compte jusqu’à 8 pendant 5 heures nonstop22. »
17Il y a un rapport d’opposition entre l’ampleur de ce qui est référé et la longueur du tweet. Sur les onze tweets consacrés au cycle du Ring, cinq font explicitement référence à la durée de l’opéra : « Seigneur des Anneaux en 20 heures, avec Dieux nordiques et inceste. Aussi, à cheval23. » ; « Ça ressemble à la Petite Sirène, si la Petite Sirène avait duré 20 heures et fini avec la mort de tout le monde24. » ; «troplongtroplongtroplongtroplongtroplongtroplongtroplongtroplongtrplongtroplong troplongtrop25 » et « Quinze heures plus tard, l’Anneau devient un cercle complet26. » L’évocation de la durée de l’opéra permet aussi de parler de l’exercice #Operaplot : au sujet de l’opéra de Messiaen, Saint-François d’Assise, parce qu’il est connu comme l’un des plus longs ouvrages du répertoire, donne lieu à un #Operaplot qui fait référence au fait d’être ramené à un seul tweet : « Saint François embrasse un lépreux, prêche, est stigmatisé, rencontre un ange, meurt… et tout est Tweeté en musique27. » Le même internaute consacre deux #Operaplot au Ring qui, au moment d’être ramené à moins de 140 caractères, est donc caractérisé par sa longueur. Mais il emploie deux manières : le résumé critique et le résumé comme jeu de genre.
Le résumé critique comme critique du fait de résumer
18« Rhinegals rassemble l’or du Rhin, Fricka pense que les monstres grondent, Freia les fait ressembler à des vieux, Erda dit que c’était prédit (Yo-Bro) » Le moins que l’on puisse dire, c’est l’opposition de format entre La Tétralogie et le tweet qui permet de jouer avec l’effet de réduction. Le temps d’un tweet étant d’autant plus particulièrement court que celui d’un opéra est le triple ou le quadruple d’un film. Pour reprendre le vocabulaire de Fontanille, on pourrait dire que l’intensité de l’operaplot repose sur un jeu de réduction de l’extensité ou que la dramatisation de sa faible extensité est un des ressorts de son intensité28. De ce point de vue, le cross-over n’est jamais qu’un accroissement de l’extensité pour mettre en scène la faible intensité : par exemple @SamNeuman fait un operaplot qui croise quatre opéras de Puccini : « Mimi29 a besoin d’un vaccin. Angelica30 a besoin d’un antidote. Tosca a besoin d’ailes. Liù31 avait juste besoin d’un passe-temps. »
19Si on peut donc parler d’un « comique de réduction » à propos des tweets #Operaplot, c’est parce que l’extensité est d’autant plus spectaculairement rétrécie qu’elle fait référence à une extensité particulièrement élargie, qui est celle d’un opéra. Avant Twitter, nous pouvons penser au sketch d’Anna Russell32 qui, dans les années 1980, résume le Ring en quelques minutes ou celui de Victor Borge33 qui résume un opéra de Mozart dans un sketch qui joue sur le fait que les ressorts principaux de l’histoire sont souvent dans le fait que des choses qui pourraient s’enchaîner de façon logique, arrivent à s’isoler dans le moment où elles se produisent. Quelques phrases de Victor Borge l’illustrent très bien : « […] le ténor fait son entrée, il est supposé rencontrer sa soprano, comme on appelle ce genre de dame, mais elle n’est pas encore arrivée. Alors il se cache derrière l’un des arbres, pour la surprendre quand elle fera son entrée un peu plus tard, ce qu’elle fait. Et quand elle fait son entrée un peu plus tard, ce qu’elle fait, elle ne peut pas le trouver car il est caché derrière l’un des arbres. »
20Certains internautes essayent de donner une vision critique des raccourcis occasionnés par la brièveté et, surtout, par la courte-vue. Tel l’Operaplot d’Otterhouse à partir de Salomé : « On pourrait parler du symbolisme, etc., mais je vais pointer ce que les gens vont trouver intéressant dans ce plot : elle est nue dans le 4è acte. » Le changement de registre est un changement d’adresse34 et permet de redoubler un changement de sujet : la critique semble porter sur une attention du public trop centrée sur la nudité de Salomé, mais elle peut aussi porter sur le spectateur d’opéra conventionnel, qui applaudit à la fin, même quand l’histoire est d’un superficiel quasi-rocambolesque. Le même @Otterhouse raconte Madame Butterfly ainsi : « Un marin séduit une japonaise mineure, la met enceinte, en épouse une autre, prend le bébé, la pousse au suicide et à la fin : on applaudit. » Sachant qu’il donne une deuxième version de Madame Butterfly, où il prend la voix de l’héroïne : « Il m’aime, il m’aime plus, il m’aime, il m’aime plus, je suis enceinte et il a une autre femme, je l’aime et il ne m’aime plus. »
21Faire résumer l’intrigue par le rôle principal, consiste alors à renvoyer l’absurdité des situations sur le compte d’une psychologie particulièrement simpliste des personnages centraux. Pour Elektra, @OperaGaga : « Je ne peux prononcer le nom de personne. Des haches, un meurtre, des cris, des cauchemars, c’est l’enfer ? Je vais faire une danse folle et tomber raide morte ! » Les #Operaplot d’@OperaGaga consistent souvent à projeter le cours de l’intrigue dans une irrationalité dont les personnages ne peuvent jamais profiter autant que les spectateurs ou, plus encore, les participants du concours sur Twitter. Ce qui vaut sans discrimination de genre opératique, puisqu’Elektra a été traitée de la même manière qu’un opéra baroque tel qu’Ariodante : « Il veut baiser Ginevra, donc il baise Dalinda dans plus d’un sens. Ça chie dans le ventilo. Tout le monde veut mourir. Tout à coup tout va bien. » Il est notable que la liste des événements consiste à déhiérarchiser leurs valeurs existentielles respectives et à mettre en évidence la gratuité de leurs associations. Ainsi, La Walkyrie que @Joncaves résume en une suite d’actions qui prend la forme d’une to-do list : « Dominer Dieu, se quereller avec sa femme, tuer son fils, renier sa fille et manquer la naissance de son petit-fils. » Quand l’énumération consiste à relever quelques faits au cours de l’intrigue, le jeu revient souvent à rapprocher des faits d’importances hétérogènes. Par exemple, quand @ScottSavros rapporte Les Noces de Figaro en une phrase : « Une série d’infortunes mène à des allégations d’infidélité, une fausse blessure, des résultats de test de paternité et quelques fleurs piétinées ! ». Ou bien @Keltyc qui résume Lucia di Lammermor : « Des fiançailles, un mariage, un meurtre, des obsèques, un suicide. En Écosse. »
22La situation opératique peut aussi servir à renforcer : pour Lucia di Lammermor, John Shaw présente son résumé comme un faux spoiler : « Elle tuera son mari pendant leur lune de miel puis chantera un air sur l’escalier. » C’est un faux spoiler, dans la mesure où il ne dit pas vraiment la fin. Dans le même ordre d’esprit, Tosca est résumé par @JudyGold : « Il peint. Elle chante. Elle vend la mèche, tue ensuite le despote. Il est tué. Elle saute. Rome ne tremble plus. »
Le résumé comme jeu de genre
23« Bonjour et bienvenue dans le Monde Merveilleux de Wagner !!! Nous vous emmènerons des filles du Rhin à la destruction d’Utter en seulement 15 jours. » Otterhouse utilise encore le ton de l’annonce dans son résumé de Lucia di Lammermoor : « A vendre : Robe de mariée, à peine utilisée. Adresse : Ravenswood. Ecosse. » Dans le même registre, @hmbmezzo résume Tosca en petite-annonce : « Diva cherche artiste pour relation durable, qui aime la gastronomie, le vin, les promenades dans la campagne et le saut à l’élastique. » Le geste stylistique tient de la substitution d’un genre par un autre : quand @amndw2 remplace le résumé de l’opéra Tosca par une situation façon Cluedo : « Signora Floria. Dans la salle à manger. Avec un couteau à steak. » Il peut aussi y avoir le bilan des pertes, par @LizzieVS : « Basse ? Poison / Baryton ? Poignard / Ténor ? Tir / Soprano ? Saut de la mort / Nombre final des morts : 4. », alors que Sereisa Derrand remplace le résumé de Tosca par un titre de faits divers : « L'envie et la luxure tuent trois personnes en Italie. »
24La substitution d’un genre par un autre, ne se veut pas systématiquement humoristique : on peut trouver dans les #Operaplot sur Tosca, le cas d’une substitution de genre, qui s’impose une revendication poétique : « Haïku : Elle vit pour l’art et l’amour / Les politiques la rendent folle / Fais attention à ce rebord. » Le choix de l’ouvrage « ploté » peut donc être investi par le jeu de substitution, même si c’est souvent à l’intérieur du tweet que les décrochements de registre sont utilisés et bouclent sur eux-mêmes. @funwithiago résume ainsi Tosca : « La diva ne peut pas trouver la femme dans l’église, l’homme dans le bien, ou la paix sur la terre, donc elle part pour trouver un trou du cul dans le Paradis. » L’emploi du « donc » indique bien que le résumé revendique de démontrer une logique qui serait restée cachée au spectateur distrait. Dans le cas de @funwithiago, le « donc » attache un comique de logique réduite au décrochement de registre, mais on peut trouver des démonstrations nettement plus affirmatives de leur montrer qu’une logique est à l’œuvre dans la construction de l’intrigue, rigoureuse alors que logiquement vrillée. Tosca est ainsi résumé par @IreneVartanoff : « Je la veux, donc vous devez mourir. Je ne vous veux pas, donc vous devez mourir. Vous êtes tous les deux morts, donc je dois mourir. »
Le point de vue de l’opération
25L'écriture journalistique stéréotypée, la petite annonce, l'écho mondain, la réclame publicitaire, les procédés de réduction reprennent la même liste de modèles parodiés que celle des épigrammes de la revue 391. Mais si une charge critique plane, la motivation demeure ludique. C’est parce qu’il y a jeu qu’il peut y avoir distanciation morale et, par exemple, le résumé de Gianni Schicchi en une seule formule proverbiale et admirablement basique : « Quand on veut, on peut. » par @Joncaves. On pourrait dire d'un tweet #operaplot, ce que Marie-Paule Berranger dit de « la sentence dadaïste nominative, allusive et stratégique » : qu’elle « maintient un état d'alerte, de suspicion, d'instabilité ; elle a essentiellement un rôle de sélection : elle définit le cerle des initiés, des “happy-few” capables de traverser la dénotation ou l'absurdité pour saisir le double-sens, percevoir l'allusion35. » Ce qui ne veut pas dire qu’on peut déduire des tweets #operaplot tout ce que Marie-Paule Berranger dit des aphorismes dada et surréalistes. Quand Soupault mobilise, pour les aligner, des petits « réflexes phatiques qui ponctuent les échanges quotidiens », Berranger fait remarquer qu’« en les privant de leur situation de dialogue et en les juxtaposant », le poète « exhibe comment la signification, loin d'être inhérente aux mots eux-mêmes est redevable au contexte, aux circonstances de l'énonciation36. » Ce dont on ne trouve pas d’équivalent consistant dans le corpus #Operaplot. On peut tout de même comparer les aphorismes ludiques des surréalistes et les tweets #operaplot du point de vue du fait qu'ils « s'accordent à considérer que l'usage commun des mots est usure de la langue37 » : même s’il serait abusif d’y voir une lutte contre l'érosion de la langue et la transparence du signe38, il acte un constat d’échec des synopsis disponibles dans les programmes distribués avant le spectacle. Et ce constat d'échec est doublé d'une sorte de rupture vis-à-vis de la communauté générale des amateurs d'opéra. C’est aussi pourquoi il n’est pas très confortable de chercher à faire un classement de ces productions « para-narratives » sur le plan diégétique. Dans Fictions transfuges, Richard Saint-Gelais propose, à propos des « contrefictionnels39 », de s’en remettre à « l’examen des opérations elles-mêmes, abstraction faite de leur contenu », avec l’ambition d’y trouver des « perspectives plus assurées40 », en reprenant les trois opérations distinguées par Uri Margolin41 : « l’addition, la soustraction et la substitution42. » Mais on est alors dans le domaine de la continuité rétroactive (« retcon »), de la projection d’une fiction dans une autre. Pour pouvoir distinguer telle ou telle opération, il faudrait pouvoir établir un rapport de conséquence entre le temps de l’intrigue originale et celui de la contrefiction. Or, à la différence d’un texte du type « retcon », les tweets #operaplot n’agissent pas sur les intrigues, mais sur les résumés d’opéra.
26Il faudrait alors se demander si le genre « résumé d’opéra » n’a pas lui-même quelques propriétés de la continuité rétroactive. Reprenons les premières lignes du résumé du premier acte d’Aida, dans le livre de Chantal Cazaux, Verdi mode d’emploi : « Les Éthiopiens sont en marche contre l’Égypte. À Memphis, le Grand Prêtre Ramfis annonce à Radamès que la déesse Isis va désigner les troupes du roi au combat. Radamès rêve d’être choisi – pour être remarqué d’Aida, l’esclave éthiopienne d’Amnéris, fille du roi. Mais justement : Amnéris aime Radamès et comprend qu’elle n’en est pas aimée en surprenant le tendre regard qu’il pose sur son esclave43. » Comme souvent dans les résumés d’opéra : les personnages sont présentés dans l’ordre d’apparition et les actions sont le fait de l’emboîtement des incompatibilités de positions que leur statut et leurs projets peuvent rencontrer. C’est peut-être pour ça qu’à la première lecture, les résumés d’opéra sont souvent difficiles à suivre : à mémoriser qui est qui, on perd le fil de ce qui se passe. Ce qui est particulièrement prononcé dans les opéras de Verdi qui, selon Chantal Cazaux, ont des livrets tortueux qui « défient certes la logique et la mémoire du spectateur… mais jamais l’intense vérité des situations et des personnages44. » Ce qui laisserait penser qu’on ne peut pas avoir, en même temps, une progression narrative limpide et une consistance lyrique belle. Sur ce plan, un certain nombre des tweets #operaplot sont des micro-fictions qui concrétisent narrativement les décrochements cognitifs produits par les résumés d’opéras. Ainsi, en appuyant sur l’absurdité des situations ou en faisant dire à l’intrigue qu’elle est, par exemple, en même temps, une tragédie du regard : La tour d’Ecrou par @Joncaves : « Les enfants voient des fantômes, la gouvernante voit le danger, le gardien ne voit rien. »
À moins que
27Au-delà du plaisir ludique, le concours #Operaplot prétend peut-être donner à l’opéra une dernière chance de survivre au consumérisme narratif. Quand, pour « ploter » Nixon in China, Otterhouse écrit : « Nouvelles, n-o-u-v-e-l-l-e-s, nnooouuvvveeelleeess, nvlls, nvlls, nouvelles, nouvelles, nouvelles, de 1972 », il y a un jeu formel avec le style prosodique de l’opéra concerné, mais il y a aussi ce qu’on pourrait appeler « l’effet slogaanizer », du nom du site internet générateur de slogans, dans lequel on peut aussi bien mettre le nom des héroïnes d’opéra et obtenir : « On a tous en nous quelque chose de Tosca. », « Cette sensation s’appelle Tosca », « Tosca et les rêves deviennent réalité ! », « Il y a des choses qui ne s’achètent pas, pour tout le reste il y a Tosca ». « Quand c’est bon c’est Tosca ! », « Avec Tosca, tout est possible » ou « Si c’est Tosca j’y vais aussi ! », « Tosca fait la force » ou « Tosca, toujours plus fort ! ».
Notes
1 L'auteur remercie Olivier Quernez pour la traduction des Operaplots :
http://theomniscientmussel.com/2011/04/operaplot-2011-winners/ [consulté le 1er février 2018]
2 La Fan Art Gallery est consultable : http://theomniscientmussel.com/2011/04/operaplot-2011-fan-art-gallery/
3 Définition https://fr.wikipedia.org/wiki/Lolcat consulté le 2 juin 2012.
4 Richard Dawkins, Le Gène égoïste [1976], trad. fr. Nicolas Jones-Gorlin, Paris, Odile Jacob 2003, cité par Vincent Glad, « Pourquoi les mèmes ne sont pas des mèmes », Culture Visuelle, 20 mai 2011. http://culturevisuelle.org/lesinternets/archives/586 [Inaccessible le 25 mai 2018]
5 Vincent Glad, « Pourquoi les mèmes... », op. cit.
6 http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html [consulté le 25 mai 2018]
7 Suivent : Tosca : 23 plots (1,92 %) ; Madame Butterfly : 23 plots (1,92 %) ; Salomé : 22 plots (1,83 %) ; La Flûte enchantée : 22 plots (1,83 %) ; Les Noces de Figaro : 21 plots (1,75 %) ; Lucia di Lammermoor : 20 plots (1,37 %) ; Le Ring : 18 plots (1,35 %) ; La Traviata : 16 plots (1,33 %) ; Le Trouvère : 15 plots (1,25 %) ; Tristan et Isolde : 14 plots (1,17 %) ; Lohengrin : 14 plots (1,17 %) ; Gianni Schicchi : 13 plots (1,08 %) ; La Walkyrie : 13 plots (1,08 %) ; Nixon in China : 13 plots (1,08 %) ; L’Elixir d’Amour : 12 plots (1 %) ; Einstein on the Beach : 11 plots (0,92 %) ; Albert Herring : 11 plots (0,92 %) ; Le Tour d’Ecrou : 11 plots (0,92 %) ; Le Chevalier à la rose : 10 plots (0,83 %) ; Samson et Dalila : 10 plots (0,83 %) ; Parsifal : 10 plots (0,83 %) ; Boris Godounov : 10 plots (0,83 %) ; Faust : 9 plots (0,75 %) ; Pelléas et Mélisande : 8 plots (0,67 %) ; Capriccio : 7 plots (0,58 %) ; Werther : 7 plots (0,58 %) ; Norma : 5 plots (0,42 %) ; L’Enlèvement au Sérail : 5 plots (0,42 %) ; Don Pasquale : 5 plots (0,42 %) ; Lady Macbeth de Mtsensk : 5 plots (0,42 %).
8 Turandot+Tosca+MadameButterfly+La Bohème+Gianni Schicchi.
9 Aida+Rigoletto+La Traviata+Le Trouvère.
10 L'Enlèvement au Sérail +La Flûte enchantée +Don Giovanni + Les Noces de Figaro+ Cosi fan tutte.
11 Le Ring+Tristan et Isolde+Lohengrin+La Walkyrie+Parsifal
12 Peter Grimes+Albert Herring+Le Tour d’écrou.
13 @DaleTrumbore
14 @primalamusica
15 @musicvstheater
16 Film pornographique ultraviolent qui peut inclure des scènes de toruture et des meurtres.
17 @musicvstheater
18 @DevonCEstes
19 @JamiePaisley
20 @sheilaheady
21 @NewMusicKulma
22 @lucidverve
23 @swashbuckles
24 @swashbuckles
25 @princessdvonb
26 @roxiezeek
27 @Otterhouse
28 Le schéma tensif est un dispositif dans lequel une valeur donnée est constituée par la combinaison de deux « valences », son intensité et son extensité (c’est-à-dire l’étendue à laquelle s’applique l’intensité). Par exemple, une émotion très intense peut être tellement intense qu’elle est sensée s’appliquer à un petit nombre de personnes, si bien qu’entre une forte intensité et une faible extensité, on sera dans une situation de corrélation. Fontanille qualifie la corrélation de « converse » ou « directe » quand l’augmentation de l’une est accompagnée par l’augmentation de l’autre (ou quand la diminution de l’autre accompagne la diminution de la une). Sinon, elle est dite « inverse » : quand, par exemple, les publicitaires passent d’une accroche fortement affective qui occupe une faible place, au reste de l’affiche, il y a ce que Fontanille appelle un « schéma de la décadence ». L’autre corrélation « inverse », c’est le schéma de l’ascendance, le passage d’une grande étendue d’assez faible intensité à une étendue faible à forte intensité : quand, en littérature, on passe du corps d’une nouvelle et sa chute, courte mais intense. Il existe aussi des schémas dits « de l’amplification » et « de l’atténuation », qui permet de distinguer le Boléro de Ravel où l’intensité et l’extensité sont proportionnellement croissantes et les drames ou les comédies dans lesquels l’intensité et l’extensité s’apaisent en même temps.
29 Dans La Bohème.
30 Dans Suor Angelica.
31 Dans Turandot.
32 Cf. Anna Russell, The (First) Farewell Concert (1984), http://www.youtube.com/watch?v=Cv7G92F2sqs [consulté le 25 mai 2018]
33 Cf. Victor Borge, A Mozart Opera, https://www.youtube.com/watch?v=ZKkZXSJO5iU [consulté le 3 juin 2018]
34 On parle, dans L’Encyclopédie de la parole, de « focalisation », https://encyclopediedelaparole.org/fr/taxonomy/term/129 [consulté le 3 juin 2018]
35 Marie-Paule Berranger, Dépaysement de l'aphorisme, Paris, Librairie José Corti, 1988, p. 38.
36 Ibid., p. 58.
37 Ibid., p. 99.
38 Ibid., p. 102.
39 Il s’agit d’un terme qui veut dire « contrefactuels de fiction », c’est-à-dire des réécritures qui affectent des faits fictifs.
40 Richard Saint-Gelais, Fictions transfuges, Paris, Seuil, 2011, p. 168.
41 Uri Margolin, “Characters and Their Versions”, dans Calin-Andrei Mihailescu et Walid Hamarneh (dir.), Fiction Updated. Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics, Toronto, University of Toronto Press, coll. “Theory/Culture”, 1996, p. 113-132.
42 Richard Saint-Gelais, ibid.
43 Chantal Cazaux, Giuseppe Verdi, mode d’emploi, Paris, Éditions Premières Loges, 2012, p. 184.
44 Id.
Pour citer ce document
Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)
