- Accueil
- > Numéros parus
- > 2021-5
- > Lauréats
- > Prendre en charge la folie durant l’après-guerre : le tournant social de la psychiatrie poitevine de 1953 à 1975
Prendre en charge la folie durant l’après-guerre : le tournant social de la psychiatrie poitevine de 1953 à 1975
Par Eva Proust
Publication en ligne le 08 mars 2022
Résumé
As all french psychiatric clinics after 1945, the Pasteur Hospital in Poitiers sought to renew itself in depth to breaking with its archaic system inherited from the asylum. The war and its many traumas played a major role in the evolution of psychiatric care, and particularly in the development of social therapies. The creation of the Cité hospitalière de la Milétrie, in 1956, was the occasion for many therapeutic innovations and successful care experiments. Some of these were pioneering in France, such as the home-based aftercare for alcoholics set up in 1954, or the first steps towards a child psychiatry service at the Milétrie hospital. A rare document also made its appearance during a testimony: the monthly Milétrie-Presse, a magazine published from 1962 to 1967 by a therapeutic workshop of the psychiatric hospital, which the remaining documents are still in the hands of a few retired nurses.
Comme tous les hôpitaux psychiatriques français après 1945, l’hôpital Pasteur de Poitiers cherche à se renouveler en profondeur afin rompre définitivement avec son système archaïque hérité de l’asile. La guerre et son lot de traumatismes ont joué un rôle majeur dans l’évolution des soins psychiatriques, et en particulier dans le développement de thérapies sociales. La création de la Cité hospitalière de la Milétrie, en 1956, est l’occasion de nombreuses innovations thérapeutiques et expériences de soin réussies. Certaines se sont avérées pionnières sur le territoire national, tel que le suivi à domicile des alcooliques en postcure mis en place dès 1954 à Pasteur, ou encore l’ébauche, à la Milétrie, du service de psychiatrie infantile. Un document rare a également fait son apparition au cours d’un témoignage : la revue mensuelle Milétrie-Presse, éditée de 1962 à 1967 par un atelier thérapeutique de la Milétrie et dont les seuls exemplaires conservés sont aux mains de quelques infirmiers retraités.
Mots-Clés
Table des matières
Article au format PDF
Prendre en charge la folie durant l’après-guerre : le tournant social de la psychiatrie poitevine de 1953 à 1975 (version PDF) (application/pdf – 1,4M)
Texte intégral
1Après la Seconde Guerre mondiale, le « fléau social n°1 » n’est plus la tuberculose qui a hanté les hôpitaux pendant des décennies : le déclin de la santé mentale et l’alcoolisme en particulier deviennent des enjeux de société majeurs1. Ils sont pris en main par les pouvoirs publics, qui veulent augmenter les moyens des hôpitaux et construire de nouveaux établissements pour faire face à l’arrivée massive d’aliénés dans les centres hospitaliers. C’est dans ce contexte que la Cité hospitalière de la Milétrie, à Poitiers, sort de terre au milieu des années 1950. La construction de la partie psychiatrique est marquée par le souvenir de la guerre, on redoute que les bâtiments prennent l’apparence de baraquements et rappellent « l’atmosphère malheureusement trop connue d’un camp »2. Les psychiatres, secoués par le scandale de la surmortalité dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre, sont mis face au bilan : On considère qu’environ 45 000 patients en psychiatrie ont succombé de malnutrition, notamment en raison des politiques de rationnement du régime de Vichy3. Comme dans d’autres départements à la sortie de la guerre, Poitiers doit se doter d’un hôpital psychiatrique départemental « au goût du jour », aux antipodes de l’hôpital Pasteur qui a conservé l’allure d’un asile et certaines méthodes considérées archaïques par la psychiatrie moderne4. Situé au bord du Clain, entre les Pont Neuf et Pont Saint-Cyprien, Pasteur est l’hôpital des fous avant la construction de la Milétrie. Avant 1955 et la création d’un diplôme d’infirmier psychiatrique, les gardiens d’asile ne possèdent pas de compétences médicales et apprennent leur métier par le biais de l’expérience5. Il s’agit plutôt de surveiller que d’envisager pour les fous une perspective de soin.
2D’un point de vue historiographique, malgré la richesse du xxe siècle pour l’histoire psychiatrique, les travaux sont rares sur la psychiatrie et la folie, en comparaison aux siècles précédents6. Selon Benoît Majerus et Volker Hess, cela s’expliquerait par l’absence de grille de lecture comparable à celle ayant été établit pour le xixe siècle grâce aux travaux de Michel Foucault ou Dirk Blasius7. Un propos à nuancer puisqu’il existe toutefois des études s’attardant sur des aspects précis de l’histoire psychiatrique du xxe siècle. On trouve une étude des objets en psychiatrie par Majerus (2013) et plus récemment l’ouvrage sur les schizophrènes de Hervé Guillemain (2018)8. Un ouvrage collectif est également paru sur le concept de déshospitalisation psychiatrique de la fin du siècle (2018)9. L’intérêt des travaux historiques sur cette période répond à trois grandes caractéristiques : libérer le discours historique de la thématique antipsychiatrique héritée des années 1970, considérer les changements sociaux dans leur ensemble et enfin, nuancer l’analyse historique grâce aux apports des autres sciences sociales10. Pour cette étude, trois types de sources ont été utilisées : les Archives Départementales de la Vienne avec les fonds « Hôpital psychiatrique départemental de la Vienne » et « Dossiers de construction, aménagement et équipement des différents sites occupés par le CHU de Poitiers », les archives hospitalières du Centre de documentation de l’hôpital Henri Laborit et enfin, les témoignages et documents personnels d’infirmiers ayant exercés sur la période étudiée.
3Avec la perspective d’un nouveau lieu d’exercice de la psychiatrie, incarnée par la Milétrie, la discipline psychiatrique aspire à tourner la page de Pasteur. Le nouvel hôpital devient le lieu idéal pour repenser l’accompagnement psychiatrique en profondeur. Tenant compte de la volonté d’insérer l’humain au cœur du processus de soin, comment les psychiatres ont-ils fait face au défi des particularismes départementaux dans un contexte d’après-guerre difficile et toutefois annonciateur de modernisation ? Plusieurs initiatives novatrices voient le jour après 1945 au sein de l’hôpital poitevin. Trois, en particulier, sont propres à l’hôpital psychiatrique de Poitiers et ont eu un retentissement à l’échelle nationale : un service pionnier de visite à domicile adressé aux alcooliques, l’édition de la revue thérapeutique Milétrie-Presse par l’hôpital et la création d’un service de pédopsychiatrie, l’un des premiers en France.
Le premier service national de post-cure alcoolique
4Dans les années 1950, la consommation d’alcool explose dans les milieux ruraux : Jusqu’à dix-neuf litres d’alcool pur sont consommés par Français et par an entre 1951 et 1957, ce qui représente un des taux les plus élevés d’Europe sur cette période11. Avec l’adoption d’une loi relative à la dangerosité des alcooliques chroniques en 1954, qui impose un suivi en cure de désintoxication, l’alcoolisme devient la nouvelle lutte des hôpitaux psychiatriques12. L’hôpital Pasteur, peu spacieux, se retrouve rapidement saturé par ces malades qui n’ont pas de réelles perspectives de sortie. Malgré des tentatives pour doubler les lits et l’installation de préfabriqués sur les berges du Clain, Pasteur ne parvient pas à accueillir tous les patients en demande. Cette tendance se retrouve à échelle nationale : Les alcooliques représentent presque 50 % de l’ensemble des malades admis dans les hôpitaux psychiatriques de l’Ouest de la France13. Il faut alors trouver, dans l’urgence, une solution pour désengorger l’hôpital sans procéder à des sorties hâtives.
5Une expérience est mise en place par le psychiatre Léon Fouks et le Dr. Gueunier, directeur départemental de la santé, dès 1954. Ils imaginent un système de visite à domicile des malades alcooliques considérés comme étant capables de vivre en autonomie, mais ils se heurtent au refus des assistantes sociales qui considèrent la tâche comme dangereuse et hors de leurs compétences14. En outre, aucun service de ce type n’est connu en France à l’époque. L’idée que l’alcoolisme est une tare incurable, voire héréditaire, persiste chez une partie de la population15. C’est finalement à un jeune infirmier psychiatrique, Yves Pautrot, qu’est confié ce travail de suivi16. Il fait partie des premiers diplômés du concours d’infirmier psychiatrique mis en place en 1953, succédant aux séculaires gardiens d’asiles17.
6Cette expérience de suivi est autorisée par l'arrêté de la Préfecture de la Vienne le 25 février 195418. Ces visites sont imaginées dans un but de prévention de potentielles rechutes, avec trois axes principaux : garantir une « réadaptation à la vie normale », œuvrer à une « surveillance médico-sociale » et « diminuer dans la plus large mesure possible la durée d’hospitalisation des malades alcooliques »19. Une voiture de fonction est mise à la disposition d'YP afin de couvrir le département de la Vienne. L’aire d’exercice de ce service s’étend sur 60 km du nord au sud de Poitiers et sur 30 km d’est en ouest20. Au début de cette mission, le 11 mars 1954, le jeune infirmier a dix-neuf malades à prendre en charge. Six mois plus tard, ce sont soixante-quinze malades qu’ils faut visiter régulièrement, à hauteur de deux à trois visites par semaine. Un an plus tard, en mars 1955, 151 malades sont inscrits au suivi à domicile21. Le bilan est très positif puisque les rechutes sont rares, moins d’une dizaine sont recensées, et l’hôpital n’est plus saturé. Mais la charge de travail augmente considérablement. En 1959, un second infirmier est engagé par l’hôpital Pasteur pour seconder Yves Pautrot dans cette tâche de suivi.
7Très vite, ce qui devait être une expérience temporaire se transforme en un service de post-cure régulier, efficace, devenant en quelques années un instrument incontournable de la prise en charge de l’alcoolisme dans le département. Ce service de post-cure alcoolique est pionnier en la matière sur le territoire national. Quelques années plus tard, un autre département se dote d’un service similaire dans le Morbihan, à l’initiative du psychiatre Régis Pagot, ancien élève de Léon Fouks22. Sortir le processus de soin de l’enceinte de l’hôpital pour le porter au plus près du milieu de vie des malades est une méthode de plus en plus adoptée dans les années suivantes, en particulier après la sectorisation psychiatrique23.
Milétrie-Presse, l’atelier-journal thérapeutique
8Alors que l’isolement a longtemps été plébiscité en psychiatrie comme base du « traitement moral », psychiatres et infirmiers de l’après-guerre constatent que l’interaction sociale est nécessaire au rétablissement d’un malade24. Pour animer le quotidien des patients au sein du nouvel hôpital psychiatrique de la Milétrie, l’association « La Cordée » est fondée en 1962. Elle permet la mise en place de nombreuses activités socio thérapeutiques – kermesses, ateliers artistiques, sorties culturelles, dont la fondation de Milétrie-Presse la même année.
9Ce journal mensuel s’inspire des modèles de revues thérapeutiques participatives, telles que L’écho des bruyères fondée à Fleury-les-Aubrais en 194925. Leur particularité est d’être à la fois rédigées par des soignés et des soignants. Publiées et diffusées par les hôpitaux eux-mêmes, ces revues circulent entre différents établissements de soin. Le docteur Lainé, dans un courrier au comité éditorial de la Milétrie, appelle à faire de Milétrie-Presse un « moyen de nous exprimer, d’établir des contacts [et de créer] une véritable communauté thérapeutique et vivante », constatant le peu de relation entre les patients, mais aussi entre les soignants des différents services26. Composé d’un comité de lecture formé de quelques psychiatres, d’infirmiers et de patients, la revue propose une variété d’articles, des témoignages de patients rares mais précieux, des poèmes et textes personnels, l’annonce de résultats sportifs. Chaque mois, un reportage est publié sur un aspect de la vie psychiatrique à l’hôpital : les ateliers ergothérapeutiques, l’utilisation de l’électroencéphalogramme en psychiatrie ou la ludothérapie. Alors qu'il frôle les 400 exemplaires vendus à son lancement, le journal Milétrie-Presse atteint les 750 exemplaires dès 1964. Sa popularité se maintient durant deux ans encore, avant de décroître à partir de 1966. Le journal est abandonné en 1967, car sa réalisation est jugée trop chronophage par certains médecins et faute d’infirmiers souhaitant reprendre la tête du comité éditorial27.
Figure 1 : Une de Milétrie-Presse, n°6, juin 1964
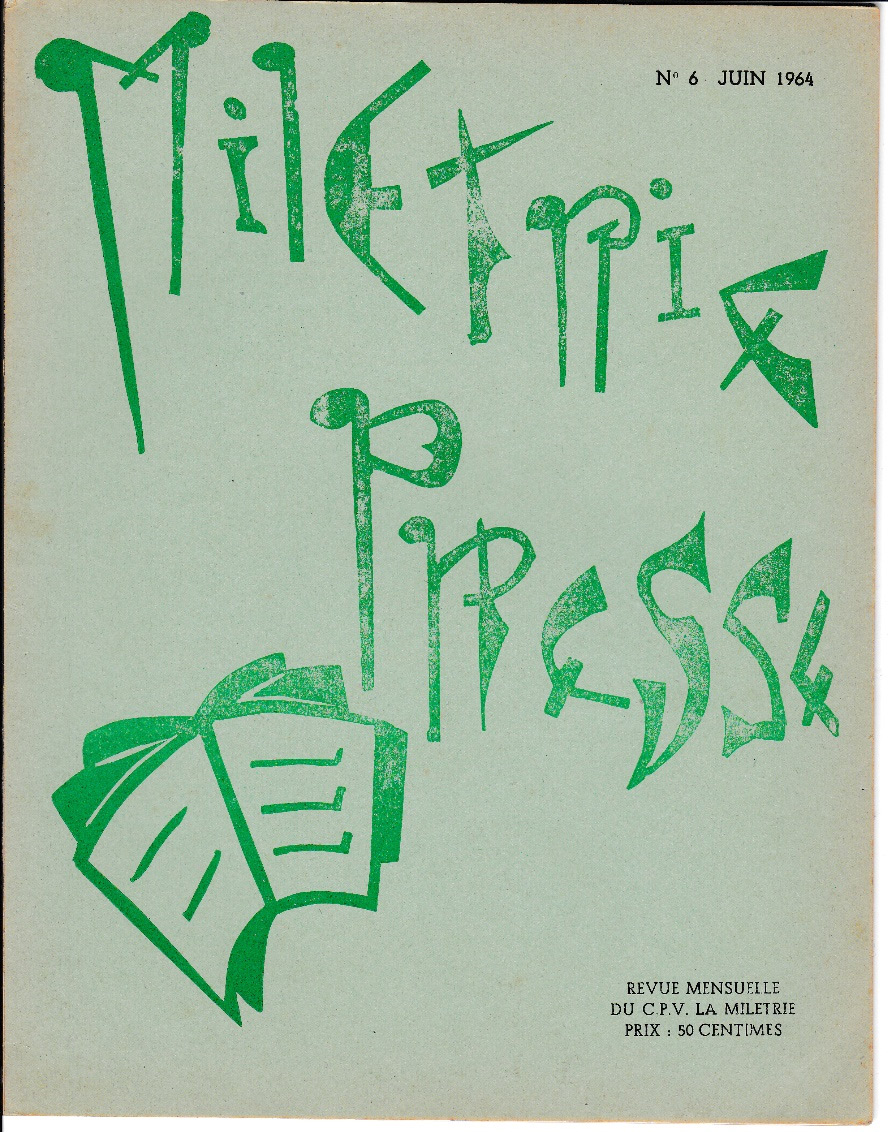
10Malgré une existence assez courte, Milétrie-Presse trouve sa place dans le paysage des revues psychiatriques participatives de l’époque. Si le but premier de la revue est socio-thérapeutique, elle devient rapidement une vitrine des offres de soin de l’hôpital psychiatrie de la Milétrie. Les services hospitaliers ont des moyens très différents d’un département à l’autre. Milétrie-Presse est ainsi lue dans les hôpitaux d’Évreux (Eure), de Ville-Évrard (Seine-Saint-Denis) et jusqu’à Marsens (canton de Fribourg, Suisse). Des échanges épistolaires réguliers entres psychiatres témoignent de l’importance de ces revues dans le paysage psychiatrique28. L’hôpital de Sainte-Marie Montredon (Haute-Loire), dans une revue de presse, fait parvenir aux responsables de Milétrie-Presse un avis positif, décrivant une « belle revue présentant une variété importante d’articles très vivants »29. La réputation de l’hôpital se joue dans les pages du journal et de fait, Milétrie-Presse est un outil promotionnel. Dans son récit, Yves Pautrot note que les articles écrits par les malades sont systématiquement relus par le comité de lecture, puis contrôlés une dernière fois par les médecins-chefs qui ont autorité sur le contenu de la revue. Si la parole des malades commence tout juste à être entendue et valorisée, il reste délicat pour le corps médical de les laisser s’exprimer librement30. On ne lit aucune critique négative au sein d’un témoignage de patient. La relecture effectuée par les médecins, sans doute accompagnée d’une forme de censure des propos dévalorisants, prouve l’importance de la réputation hospitalière en milieu psychiatrique où la recherche du bien-être des malades est prioritaire.
11Toutefois, malgré sa portée non-négligeable durant les années 1960, la mention de Milétrie-Presse est absente des archives hospitalières et des publications parues sur l’hôpital poitevin. Les rares exemplaires conservés appartiennent à quelques infirmiers retraités. En prenant compte de la difficulté à étudier cette revue, cette analyse de Milétrie-Presse se base sur neuf numéros conservés par Yves Pautrot, d’octobre 1962 à janvier 1966. Dans le premier numéro, un article intitulé « Connaissez-vous la Milétrie ? » révèle à quel point son auteur, le directeur René Fruchard, a conscience de la portée historique des écrits publiés. Dans son dernier paragraphe, il s’adresse aux contributeurs et envisage Milétrie-Presse comme un futur moyen de retracer l’histoire psychiatrique de l’hôpital poitevin – et à juste titre : « Témoin d’un moment, soyez-en les chroniqueurs objectifs et précis. C’est peut-être un jour dans cette tradition écrite au jour le jour que nous chercherons à suivre les grandes étapes de l’évolution hospitalière31. »
La psychiatrie infanto-juvénile, un secteur à inventer
12Dans la logique d’adapter le soin psychiatrique à tous les publics, les soignants cherchent à spécialiser leur pratique. Cette volonté s’incarne à travers la création du Service de pédopsychiatrie de la Milétrie, un des premiers à voir le jour en France. Le pavillon Lagrange accueille exclusivement des enfants et adolescents à partir de janvier 196832. Il reçoit ses usagers préalablement passés par un centre de consultation de neuropsychiatrie infantiles (NPI). En 1967, il existe six centres au sein du département, à Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, Chauvigny et Civray33. Auparavant, aucune structure n’était apte à diagnostiquer les mineurs. Il fallait donc penser et expérimenter de A à Z le soin infantile, sur la base des méthodes acquises en psychiatrie adulte.
13Un courrier de 1967, envoyé par le ministère des Affaires sociales et de la santé à l’hôpital de la Milétrie, est accompagné d’un programme d’aménagement détaillé pour le futur pavillon infanto-juvénile, que le département de la Vienne est invité à suivre34. Ce programme propose l’installation d’une centaine de lits répartis selon trois catégories de malades : la neuropsychiatrie infantile, le secteur des « arriérés profonds » et celui des « grabataires, (infirmes moteurs cérébraux, arriérés profonds invalides) ». Le programme d’aménagement prévoit aussi une « zone d’activités dirigées et de divertissement » avec des ateliers scolaires ou des « classes de perfectionnement du primaire au professionnel »35.
14Ce nouveau secteur est l’occasion pour le psychiatre Tony Lainé de se spécialiser dans la pédopsychiatrie. Il s’appuie sur son réseau local et contacte plusieurs organismes dédiés à l’enfance aux alentours de Châtellerault, dans l’objectif de créer une coopération entre institutions. Loin d’imaginer une pédopsychiatrie strictement hospitalière, il s’agit de créer des lieux d’accueils ambulatoires au plus près des enfants et de former des parcours de soin cohérents. Parmi ces structures, on trouve le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), l’Internat médico-pédagogique (IMP) ou le foyer de semi-liberté, dédié aux jeunes délinquants ayant besoin d’un suivi psychologique36. Tony Lainé met l’accent sur la pédagogie et la rééducation afin de garantir la continuité de la scolarité, à une époque où les recherches sur l’enfance démontrent l’importance de l’apprentissage dans le développement social et cognitif37. Face à la demande, et pour éviter l’engorgement de son service, Tony Lainé systématise le recours aux familles d’accueil et à l’hôpital de jour. Ce choix se révèle très efficace : Cinq ans après la création du service pédopsychiatrique, la partie dédiée aux hospitalisations à temps complet ferme définitivement38. Tous les enfants sont pris en charge en ambulatoire. Il s'agit d'un succès pour le service qui s’était fixé l’objectif de proposer une alternative pérenne au séjour hospitalier39.
15Les psychiatres ne sont toutefois pas les seuls à imaginer la pédopsychiatrie. Les infirmiers, qui sont traditionnellement cantonnés par les médecins à la fonction d’exécutants, ont une place de choix dans l’élaboration des protocoles de soin infanto-juvénile. En 1968, Franck Fabien est l’un des premiers infirmiers à rejoindre l’équipe du Dr. Lainé au sein du pavillon pédopsychiatrique40. En juillet 1968, à l’issue d’un séjour en camping avec quelques adolescents, Franck Fabien et l’un de ses collègues publient un article dans un bulletin de liaison adressé aux autres infirmiers. Il raconte qu’infirmiers et adolescents ont établi leur tente au camping municipal de Gouex, dans le sud de la Vienne. Le groupe est composé de deux infirmiers encadrants et de dix garçons ayant entre 14 et 16 ans, hospitalisés pour des pathologies diverses : « épileptiques, caractériels, débiles légers et moyens »41. L’objectif du séjour est qualifié de « resocialisation » par les infirmiers dans leur bulletin de liaison42 :
16La relation quotidienne avec les touristes, les habitants et surtout les commerçants a obligé les garçons à corriger leur tenue et leur manière de s’exprimer. […] Nous avons vu disparaître les colères, certaines attitudes d’opposition et surtout un langage trivial souvent employé habituellement. Il est apparu également que chacun surveillait davantage sa tenue vestimentaire, à la piscine, au jeu de boules, au volleyball, certains d’entre eux avaient adopté l’attitude du comme tout le monde43.
17La validation collective d’une méthode par l’équipe soignante est un moyen de confirmer son efficacité et de l’inclure dans un protocole de soin. Par-delà la recherche de thérapies pédopsychiatriques, ces moments participent à la construction d’une identité professionnelle en tant qu’infirmier de secteur psychiatrique spécialisé en soin infantile.
18Cette étude de l’histoire psychiatrique, à l'échelle du département de la Vienne, permet un récit plus nuancé de l’évolution des soins psychiatriques, on constate ainsi un écart entre le discours général de l’institution et les pratiques locales des établissements psychiatriques44. Au sein de la construction d’une historiographie sur la psychiatrie d’après-guerre, les archives médicales et administratives sont des supports qui fournissent de précieux renseignements sur le fonctionnement d’un hôpital et permettent de dresser des études locales qui mettent en lumière les singularités de l’histoire psychiatrique française.
Bibliographie
KLEIN Alexandre, GUILLEMAIN Hervé, THIFAULT Marie-Claude (dir.), La fin de l’asile ? Histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l’espace francophone au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
LAINÉ Tony, Le défi de la folie. Psychiatrie et politique (1966-1992), Paris, Éditions Lignes, 2018.
MAJERUS Benoît, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Rennes, presses universitaires de Rennes, 2013.
MURARD Lion, FOURQUET François, PRELI Georges (dir.), Histoire de la psychiatrie de secteur ou le secteur impossible ?, Éditions Recherches, n°17, 1975.
POROT Antoine, Manuel alphabétique de psychiatrie, Paris, Presses universitaires de France, 1960.
Notes
1 C’est ainsi qu’Hervé Bazin parle de l’explosion des cas de « folie » dans les hôpitaux français au début des années 1950, dans Réalités, 1955, p. 59.
2 Dans son rapport de 1949 destiné à la Commission administrative des hôpitaux de Poitiers, l’architecte départemental Jean-Marcel Boudoin évoque le risque que le nouvel hôpital psychiatrique ressemble à un camp et souhaite s’inspirer de l’architecture des hôpitaux suédois pour créer des pavillons accueillants. Arch. Dép. de la Vienne, cote 3097 W 56.
3 Danièle Voldman, « Isabelle Von Bueltzingsloewen, L'Hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'Occupation, Paris, Aubier, 2007, 508 p. », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 55-4, n° 4, 2008, p. 234.
4 Les soignants de Pasteur et de l’Hôtel-Dieu qualifiaient ainsi le nouvel hôpital à la Milétrie.
5 Julien de Miribel, L’expérience infirmière en psychiatrie et santé mentale : enquête sur les dynamiques de professionnalisation et de construction du rapport au métier. Thèse de doctorat en éducation, Université Charles de Gaulle - Lille III, 2017, p. 218.
6 Volker Hess, Benoît Majerus, “Writing the history of psychiatry in the 20th century”, Hist Pasychiatry, 2011, vol. 22 (86 pt 2), p. 139-145.
7 Ibid.
8 Benoit Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013, et Hervé Guillemain, Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires de l’histoire, Éditions Alma, 2018.
9 Alexandre Klein, Hervé Guillemain, Marie-Claude Thifault (dir.), La fin de l'asile ? Histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l’espace francophone au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
10 Volker Hess, Benoît Majerus, “Writing the history of psychiatry in the 20th century”, Hist Pasychiatry, 2011, vol. 22 (86 pt 2), p. 139-145.
11 Francisco Munoz Perez, Alfred Nizard, « Alcool, tabac et mortalité en France depuis 1950. Incidence de la consommation d'alcool et de tabac sur la mortalité », Population, 48ᵉ année, n°4, 1993, p. 978. https://www.cairn.info/revue-population-1993-4-page-975.htm
12 La loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui vient compléter celle de 1838. Elle peut imposer une cure de désintoxication dans des établissements spécialisés et prévoit des sanctions pénales en cas de refus.
13 Antoine Porot, Manuel alphabétique de psychiatrie, Paris, PUF, 1960, p. 22.
14 Témoignage d’Yves Pautrot, infirmier psychiatrique à la retraite, dans son récit Quand la mer se retire. De la psychiatrie poitevine à l’alcoologie (non publié), 2008, p. 110.
15 Bernand Carmen, « La spiritualité de l'imperfection des alcooliques repentis. Étapes d'un voyage », Communications, n°62, 1996. Vivre avec les drogues, sous la direction de Alain Ehrenberg. pp. 257-276. https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1996_num_62_1_1949
16 Yves Pautrot, Quand la mer se retire, op. cit., p. 112.
17 Anne-Marie Leyreloup, « Entre hier et aujourd'hui, le métier d'infirmier en psychiatrie », Sud/Nord, 2010/1, n° 25, p. 121-128. https://www.cairn.info/revue-sud-nord-2010-1-page-121.htm
18 Arrêté préfectoral du 25 février 1954 autorisant l’existence légale du service de post-cure, après réception d’un avis favorable du ministère de la Santé et de la population.
19 Article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 février 1954. Yves Pautrot, Quand la mer se retire, op. cit., p. 118.
20 Article 5 de l’arrêté préfectoral du 25 février 1954. Ibid., p. 119.
21 Il s’agit des chiffres relevés par l’équipe de Pasteur et notés dans un carnet de travail. Ibid., p. 144.
22 Gérard Simmat, Le Poitiers des années 50, Lavoux, Éditions Michel Fontaine, 2009, p. 110.
23 Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales (non-parue au Journal Officiel).
24 Natalie Giloux, « Isolement en psychiatrie : rien n’est jamais acquis », L'information psychiatrique, vol. 93, n° 10, 2017, p. 837-839. https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-837.htm
25 Germaine Le Guillant, « Fleury-lès-Aubrais 1948 : Les Ceméa s'engagent dans le champ de la santé mentale », VST - Vie sociale et traitements, vol. 72, n° 4, 2001, p. 50-51. https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2001-4-page-50.htm
26 Lettre de Tony Lainé à Yves Pautrot pour le lancement de Milétrie-Presse, 1962. Coll. Yves Pautrot.
27 Dans un courrier non-daté émis par l’assistant du docteur Fouks au comité éditorial, on lit que le travail supplémentaire que représente l’édition de la revue se fait au détriment du métier de soignant. Coll. Yves Pautrot.
28 Plusieurs courriers émis par les psychiatres poitevins mentionnent des rencontres et l’organisation de colloques avec des collègues de toute la France. Archives du Centre de documentation Henri Laborit, Poitiers.
29 Revue de presse publiée dans Milétrie-Presse, numéro non-renseigné. Coll. Yves Pautrot.
30 Hervé Guillemain, « Le soin en psychiatrie dans la France des années 1930 », Histoire, médecine et santé, n° 7, 2015, p. 77-90.
31 René Fruchard, « Connaissez-vous la Milétrie ? » dans Milétrie-Presse, octobre 1962, p. 8-10. Coll. Yves Pautrot.
32 Lettre du ministère des affaires sociales et de la santé au département, 1967. Arch. Dép. de la Vienne, fonds Dossiers de construction, aménagement, équipements des différents sites occupés par le CHU de Poitiers, 3097 W 156.
33 Yves Pautrot, Quand la mer se retire, op. cit., p. 280.
34 Programme détaillé relatif à l’aménagement du pavillon pédopsychiatrique, 29 novembre 1967, 3 pages. Arch. Dép. de la Vienne, fonds Dossier de construction, aménagement, équipement des différents sites occupés par le CHU de Poitiers, 3097 W 156.
35 Ibid., p. 2.
36 Yves Pautrot, Quand la mer se retire, op. cit., p. 280.
37 Suzie Blanchard, « Une scolarité à la carte pour des jeunes en difficulté », Enfances & Psy, vol. 16, n° 4, 2001, p. 109-113. https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2001-4-page-109.htm
38 Courrier de l’hôpital psychiatrique à la direction départementale de la santé, 1973. Arch. Dép. de la Vienne, fonds Dossier de construction, aménagement, équipement des différents sites occupés par le CHU de Poitiers, 3097 W 156.
39 Martin Pavelka, « Prendre soin de l’enfant et respecter ses parents », Adriana Bagnulo éd., Les visites médiatisées dans le cadre de la protection de l’enfance. Quel dialogue entre la famille, la justice, le social et la clinique ?, Editions Greupp, 2015, p. 63-80. https://www.cairn.info/les-visites-mediatisees-dans-le-cadre--9782906323247-page-63.html
40 Franck Fabien, Plaidoyer pour un métier peu ordinaire, Paris, Publibook, 2001, p. 85-95.
41 Ibid., p. 91.
42 Citation du bulletin de liaison de 1968 par Franck Fabien dans Plaidoyer pour un métier peu ordinaire, op. cit., p. 91.
43 Ibid., p. 92.
44 Isabelle von Buelzingsloewen, « Vers un désenclavement de l’histoire de la psychiatrie », Le Mouvement Social, vol. 253, n° 4, 2015, p. 3-11. https://www.cairn.info/journal-le-mouvement-social-2015-4-page-3.htm
Pour citer ce document
Quelques mots à propos de : Eva Proust
Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)